Regard de Pierre Vianin sur l’école valaisanne
Si Pierre Vianin est incontestablement l’une des figures de l’école valaisanne, sa caractéristique singulière, c’est d’aimer jouer avec les concepts théoriques tout en ayant toujours conservé un pied dans la pratique, alors même qu’il enseignait à la HEP-VS. Il a écrit plusieurs ouvrages publiés aux éditions De Boeck Supérieur, parmi lesquels Comprendre l’échec scolaire.
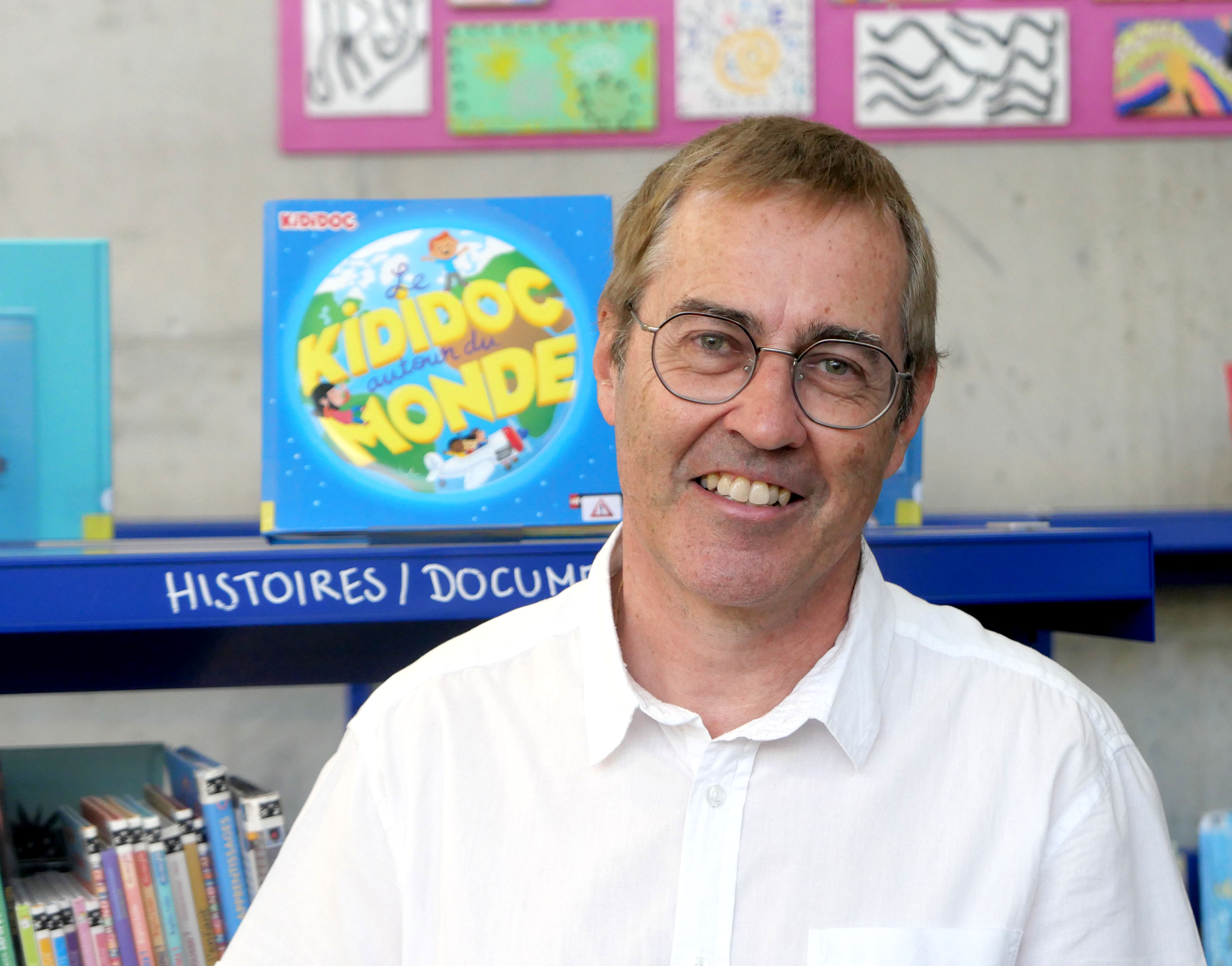
«Je suis persuadé que l’on devrait plus entraîner les élèves à s’auto-évaluer.»
Pierre Vianin
Enseignant spécialisé à l’école primaire de Noës, Pierre Vianin se place encore aujourd’hui, malgré ses années d’expérience, dans la posture de l’enseignant en formation et en recherche, à la quête d’indices pour pouvoir accompagner au mieux les élèves en difficulté. Même s’il rêve d’une école valaisanne plus audacieuse pour relever les défis actuels et futurs, il est admiratif de la capacité des acteurs scolaires à se mettre autour d’une table pour discuter de la situation d’un seul élève.
INTERVIEW
Si vous deviez citer…
Un souvenir gravé dans votre cœur d’enseignant spécialisé?
Ce qui me touche le plus, c’est de croiser un ou une élève qui était en grande difficulté scolaire et qui garde un bon souvenir de l’appui. J’aime l’idée d’avoir pu être un tuteur de résilience pour quelques-uns.
Une réforme pédagogique ayant impacté positivement votre enseignement?
Ce qui a changé radicalement ma manière de travailler en appui, c’est la prise en compte des capacités transversales dans le Plan d’études romand. Cela a légitimé l’outillage que j’essaie d’apporter aux élèves, en osant des méthodes alternatives afin qu’ils découvrent les stratégies d’apprentissage qui leur correspondent.
Une date ou une période à retenir de l’école valaisanne?
Malgré l’échec de la votation, je pense à Education 2000, car c’était un moment stimulant de réflexion et de débat.
Deux figures ayant marqué l’enseignement spécialisé en Valais?
Sans hésiter, Philippe Theytaz. Beaucoup ignorent probablement combien il a changé en profondeur notre école dans les années 80, avec un premier concept de l’appui absolument visionnaire. Et du côté féminin, même si elle ne fait pas partie des autorités scolaires, je songe à Isabelle Bétrisey qui, avec sa double formation d’enseignante et de psychologue, apporte beaucoup à la formation des enseignants.
Une piste pour donner à la visée de l’école inclusive les moyens de ses ambitions en tenant compte des évolutions de la population scolaire?
L’urgence selon moi serait de s’intéresser aux causes de la problématique des élèves ayant un comportement difficile. La communication de rentrée de l’Office de l’enseignement spécialisé faisant état de 300 situations d’absentéisme devrait faire plus que nous alarmer.
«Le métier d’enseignant spécialisé est passionnant si l’on est dans la posture du lecteur-chercheur assidu.»
Pierre Vianin
Une stratégie à avoir dans sa besace d’enseignant (et pas seulement d’enseignant spécialisé) pour essayer de motiver les élèves rencontrant des difficultés malgré leurs efforts?
L’autodétermination de l’élève me semble être une entrée simple et fonctionnelle, sachant que la possibilité de choisir impacte tout naturellement l’investissement dans les apprentissages et la motivation intrinsèque. Ce qui interroge, c’est que l’élève est invité à faire plus de choix dans les petits degrés que dans les grands degrés!
Une technique la plupart du temps utile pour aider les élèves à apprendre?
Je suis persuadé que l’on devrait plus entraîner les élèves à s’auto-évaluer par rapport à un savoir ou à une compétence.
Un changement de regard sur l’élève que l’école devrait avoir?
Croire au principe d’éducabilité, sachant que tous nos élèves ont «la lumière à tous les étages», selon l’expression d’un collègue, et que le travail de l’enseignant consiste à trouver l’interrupteur! (rire).
Un changement de regard sur l’école que certains parents devraient avoir?
Même si je trouve la collaboration avec les parents dans l’ensemble excellente, j’aimerais parfois voir le travail mené dans les écoles davantage admiré, car enseigner est un métier particulièrement complexe dont tout le monde n’a pas conscience.
Une faute pour laquelle il faudrait avoir plus d’indulgence, mais qui trop souvent hérisse les enseignants?
A la fin du cycle 1, ce qui irrite beaucoup les enseignants, ce sont les élèves qui ne maîtrisent pas la majuscule en début de phrase, alors que pour moi c’est un problème «minuscule» (sourire). Ce type de réactions me semble révélateur du manque de clarté dans les priorités à avoir.
Un argument pour devenir enseignant spécialisé aujourd’hui?
Le métier d’enseignant spécialisé est passionnant si l’on est dans la posture du lecteur-chercheur assidu. Peut-être que c’est une dimension que la HEP ne réussit pas suffisamment à transmettre aux futurs enseignants et à propos duquel il faudrait se questionner.
Un remède pour éviter que les enseignants ne s’essoufflent?
Pour moi, c’est la même chose que l’argument pour devenir enseignant. C’est seulement en lisant de la théorie pour s’auto-alimenter en réflexions pédagogiques que l’on peut s’interroger sur sa pratique et la faire bouger.
Une bonne pratique du passé qui mériterait d’être ré-importée avec des ajustements?
Je ne suis pas nostalgique du passé, toutefois je me demande parfois si dans l’école actuelle la place accordée aux travaux de groupe m’aurait convenu lorsque j’étais élève, car j’étais hyper-timide. Autre proposition qui peut paraître réac, je suggèrerais la réintroduction de la prière du matin (rire) ou de la minute de silence, les rituels permettant de mieux gérer la classe.
Une bonne pratique d’ailleurs qui pourrait être intéressante à importer avec bien sûr des ajustements?
Mon plus grand crève-cœur est que l’école valaisanne ne se soit pas inspirée des pays ayant supprimé le redoublement, tout en valorisant une école fondée sur le plaisir et l’exigence.
Un motif de confiance ou d’inquiétude face à l’IA?
Il s’agit d’être confiant du fait que c’est un outil révolutionnaire, et en même temps inquiet, car on ne sait pas vers quelle révolution l’IA nous amènera. L’école devrait apprendre aux élèves à avoir un regard critique sur l’outil, cependant c’est difficile sans connaître ses finalités.
Un des défis prioritaires pour l’école valaisanne de demain?
Je rêverais d’un vaste débat sociétal autour de la question suivante: «A quoi sert l’école?». Discuter des finalités de l’école me paraît urgentissime, mais je ne sais pas quand nous nous lancerons. Le bateau-école est si grand qu’on a de la difficulté à modifier la direction du gouvernail pour changer la trajectoire. Il nous faudrait collectivement un élan pétillant et c’est peut-être l’intelligence artificielle qui obligera l’école à se repenser en profondeur…
Une audace à oser pour insuffler le plaisir d’apprendre à davantage d’élèves?
Pour avoir cette audace, je recommande la lecture du livre de Carl R. Rogers qui s’intitule Liberté pour apprendre (livre réédité chez Dunod en 2013). Et si l’on demandait plus souvent aux élèves ce qu’ils ont envie d’apprendre?
Propos recueillis par Nadia Revaz
SI VOUS ÊTES CURIEUX
Education 2000: projet de réforme pour l'école valaisanne https://bit.ly/3UwiM3T
Film sur l’appui pédagogique en Valais (ORDP, 1989): https://bit.ly/4fT0SlB