Une image moderne des langues anciennes avec Véronique Chervaz
Pourquoi apprendre le latin ou le grec aujourd’hui? Nombreux sont les adultes, et par ricochet les adolescents, qui estiment que c’est difficile et inutile. Afin de dépasser les clichés, Résonances vous propose d’aller à la rencontre d’étudiants dans deux cours de Véronique Chervaz au Lycée-Collège de Saint-Maurice, avant de dialoguer avec cette professeure passionnée pour qu’elle complète l’argumentaire.
L’option latin en 1re année
Commençons par assister à un cours destiné aux étudiants qui ont choisi l’option latin en première année. S’ils ont privilégié le latin à l’italien, les étudiants avancent toute une liste d’arguments. «L’accès aux récits de la mythologie romaine» est cité en premier, s’ensuivent «des connaissances linguistiques», «un éclairage historique» ou «une initiation utile pour de futurs cours en droit romain».
Ce jour-là, les étudiants sont invités à traduire en duo la suite d’un texte sur le règne d’Ancus Marcius dans lequel il est dit qu’on peut lire sa vie dans un livre de Tite-Live, démontrant ainsi qu’après deux mois de collège ils ont déjà acquis certaines compétences, même s’ils ne maîtrisent bien évidemment pas les subtilités de la langue. Ils avancent en solo avant d’échanger lorsqu’il y a doute. Quelques minutes plus tard, Véronique Chervaz interroge tour à tour des étudiants pour corriger ensemble un paragraphe. Même après qu’une bonne réponse soit proposée, certains n’hésitent pas à livrer leurs traductions erronées, de manière à bien cerner ce qui leur a fait obstacle, car il s’agit presque d’une discussion. A plusieurs reprises, l’enseignante reprend les élèves au niveau de la formulation en français, rappelant pour exemple que «propter», signifiant «à cause de» doit parfois être transformé en «grâce à» dans un contexte positif. Elle les félicite dès qu’une phrase partagée est correctement construite. Le point de grammaire traité avec cet exercice de traduction concerne les composés du verbe sum/être. L’un des étudiants vient devant la classe pour un exercice consistant à se positionner en interprétant «absum/loin de», «adsum/près de», etc. L’enseignante relance l’activité en duo, passe dans les rangs et partage parfois certaines réflexions utiles à tous, notamment à propos des mots transparents («audácia» pour «audace») ou signale qu’ils peuvent visualiser sur la carte où se situe le port d’Ostie.
Aux yeux des étudiants, quels sont les bénéfices de ce genre d’exercices? Pour l’un d’eux, «la traduction est une énigme et lorsque la solution est trouvée, c’est comme une délivrance ou…» «La résolution de l’énigme, c’est donc le Graal», résume l’enseignante en souriant. Un autre collégien relève que dans ce cours, «la manière d’enseigner est sympathique, donc celle d’apprendre motivante». Plusieurs soulignent que les exercices de traduction sont complétés par une approche de la culture antique, aussi ce n’est jamais ennuyeux. Pour exemple, dans un cours précédent, l’enseignante leur a présenté le Serment des Horaces de Jacques-Louis David, illustrant un moment légendaire de l’histoire de Rome.
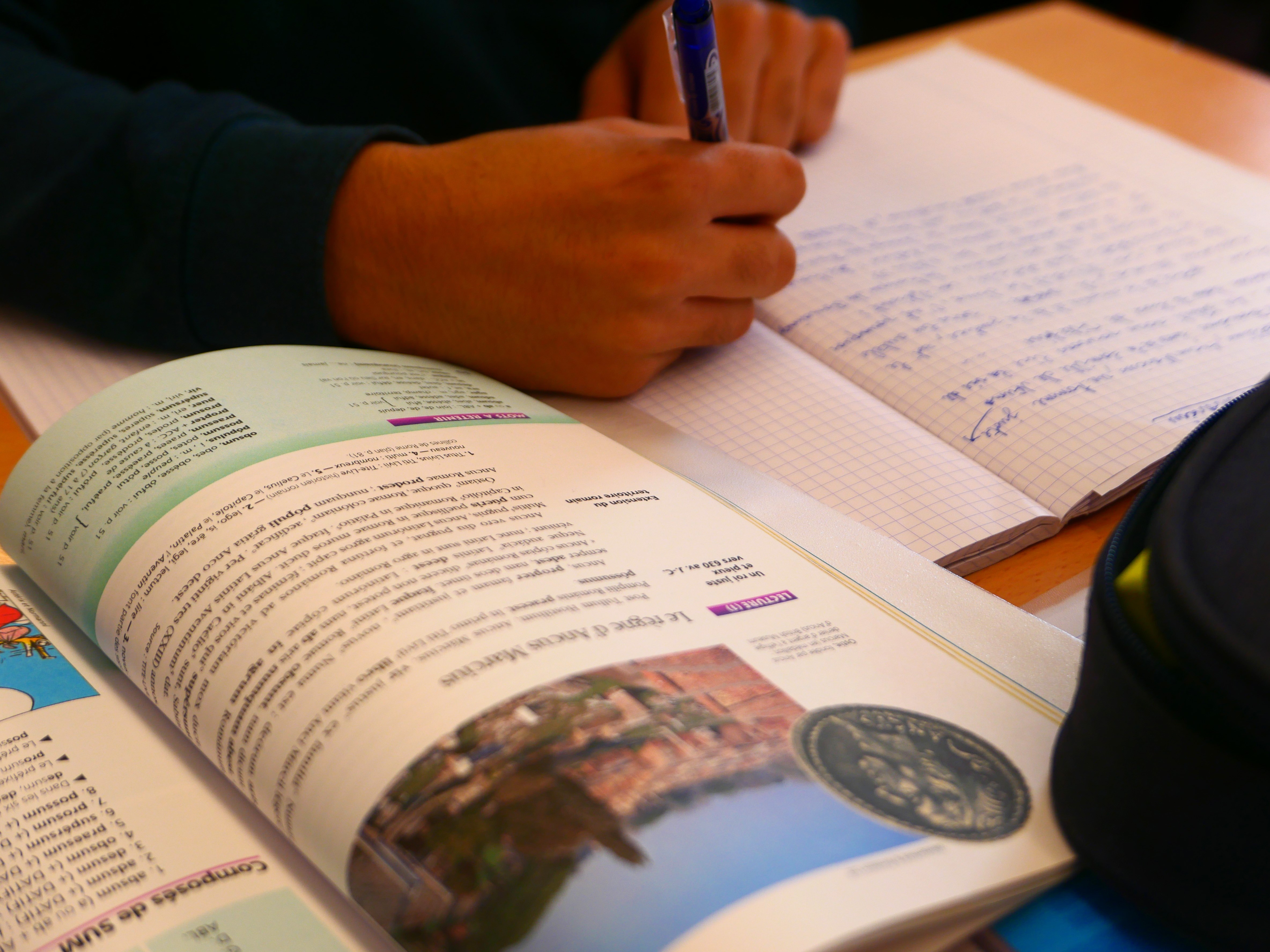
L’option latin-grec en 2e année
Découvrons un autre cours dans une classe de 2e année, composée de 11 collégiens qui étudient à la fois le latin et le grec. En décortiquant une scène de l’Aululária (la marmite) de Plaute, le cours a permis d’établir des parallèles avec l’Avare de Molière, Euclion étant la source d’inspiration du personnage d’Harpagon. La scène que les collégiens jouent avec une belle énergie présente des similitudes avec la pièce de Molière où Harpagon, avare soupçonneux, demande à la Flèche de lui montrer ses mains. En contexte, auriez-vous immédiatement deviné la traduction de «Quid abstulísti hinc?»?
Qu’est-ce qui a incité ces jeunes à intégrer les langues anciennes dans leur cursus de formation gymnasiale? L’un des collégiens explique avec fougue ce qui l’a motivé: «Ayant apprécié les cours de l’option latin en première année, j’ai assez naturellement décidé de prendre le grec en complément, de façon à pouvoir me plonger dans la culture antique qui est tellement extraordinaire.» Les justifications faisant écho à la maîtrise du français sont évidemment mises en avant, à savoir que «c’est la base de toutes les langues latines» ou que «même sans tout connaître du fonctionnement linguistique, cela aide à comprendre des mots de vocabulaire inconnus en français, simplement grâce à l’étymologie d’un préfixe ou d’un suffixe». Une étudiante donne un exemple concret d’une utilité plus indirecte: «C’est en commençant le latin que j’ai réussi à comprendre le système des cas en allemand, car jusque-là, malgré plusieurs années d’apprentissage de cette langue, je n’avais pas bien saisi la distinction entre nominatif, accusatif et datif.» Quelques raisons stratégiques sont aussi évoquées, du type: «Si on est timide et qu’on n’aime pas trop les exercices de conversation dans les cours de langues, être en option de latin-grec est idéal.» Un étudiant observe que la plupart des jeunes choisissent leurs options en fonction de leur futur professionnel, alors que «le collège n’est pas une école spécialisée, donc autant en profiter pour parfaire sa culture générale, en investissant sur le long terme». Il livre un argument percutant: «L’option latin-grec permet de mieux comprendre notre civilisation occidentale et notre continent européen.»
Grâce au travail méthodique associé à l’exercice de traduction, les collégiens acquièrent-ils un sens de la logique? Ils répondent par l’affirmative. Véronique Chervaz confirme: «Le latin est structuré de telle sorte qu’il est impossible de le traduire sans faire preuve de rigueur intellectuelle, sans aller chercher avec méthode le sujet, le verbe, etc.» L’un des jeunes exemplifie: «Quand on lit une phrase, on doit d’abord l’observer dans son ensemble, et ensuite il s’agit de comprendre les différentes fonctions correspondant aux mots.» «Pour moi, traduire un texte latin, c’est un peu une chasse au trésor, donc je le vis comme un amusement», constate un autre étudiant. Dixit une autre voix: «Ce qui est captivant, c’est que la traduction littérale ne suffit pas et qu’il faut passer par l’étape du sens pour reformuler la phrase afin qu’elle sonne juste en français.»
Apprendre des langues anciennes, est-ce une piste pour mieux comprendre le présent? Pour l’enseignante, cette dimension est fondamentale: «En ce moment, on s’intéresse à la loi Oppia interdisant aux femmes de porter des bijoux parce que ça coûtait trop cher, et à partir de là, on peut établir des parallèles sur la manière dont sont considérées les femmes aujourd’hui dans le monde.» Elle insiste: «étudier le latin et le grec, ce n’est pas être détaché de l’actualité, car beaucoup d’éléments abordés en cours résonnent avec notre époque.» Elle considère que ses cours sont l’occasion de mettre en lumière les femmes qui ont traversé l’histoire ou de voir que certains grands empereurs, comme Néron, ont des airs très contemporains.
Les cours de latin et de grec sont-ils plaisants? L’ambiance à la fois studieuse et décontractée de la classe vaut bien plus que des mots. Les étudiants décrivent des cours variés et intéressants, basés sur un manuel qui alterne activités linguistiques et ouverture culturelle. Ainsi que le relève l’enseignante, «la matière est abordée par séquences autour de thèmes, historiques ou artistiques, avec des points de grammaire qui sont introduits de manière progressive». Une étudiante poursuit en précisant qu’il y a un autre aspect fondamental. Elle laisse un petit silence, contribuant volontairement ou non au suspense. «Les profs de latin et grec sont incroyables, car ils sont tous passionnés.» Pour elle, la garantie de la qualité des enseignants dans ces branches constitue l’un des critères pour choisir cette option. Tous relèvent le caractère très agréable de fonctionner au sein d’un petit groupe classe, propice à la concentration, mais aussi au rire.
Les collégiens latinistes et hellénistes souffrent-ils du déficit d’image de leurs branches d’études dans la société? Une étudiante raconte qu’une personne lui a récemment dit sur un ton un peu cassant qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’acquérir des connaissances inutiles. Selon elle, ce genre de réaction due à la méconnaissance n’est pas trop douloureuse, car au sein de la classe tout le monde est convaincu de l’importance de ces matières. «Grâce à cette option, nous nous construisons un solide bagage culturel à partir de ce que l’histoire nous a légué», dit-elle en réponse aux grincheux.

«Le monde de l’Antiquité me passionnait et me passionne toujours, d’autant que notre présent y puise ses sources.»
Véronique Chervaz
INTERVIEW DE VÉRONIQUE CHERVAZ
Après sa maturité latin-grec au Lycée-Collège de Saint-Maurice, Véronique Chervaz a obtenu une licence à la Faculté des lettres (grec, archéologie et histoire ancienne) de l’Université de Lausanne. Elle a ensuite suivi son mari au centre de la France, a passé le Capes (certificat d’aptitude au professorat du second degré) et a enseigné pendant treize ans dans une zone d’éducation prioritaire, en donnant des cours de français, de latin et de grec. En 2010, de retour en Suisse, elle a décroché un poste pour enseigner le français et l’éthique et cultures religieuses (ECR) au CO de Vouvry et y a travaillé jusqu’en 2020. Depuis, elle enseigne le français et les langues anciennes au Lycée-Collège de Saint-Maurice, étant par ailleurs responsable du groupe de branches latin-grec depuis l’année dernière.
Véronique Chervaz, quelle a été votre motivation initiale pour vos branches d’études?
J’ai toujours su que je voulais étudier ce qui me plaisait, sans viser la dimension de l’utilité immédiate. Le monde de l’Antiquité me passionnait et me passionne toujours, d’autant que notre présent y puise ses sources.
A quel moment, avez-vous envisagé de devenir enseignante?
Avec ma licence en poche et en étant en France, la solution de facilité, c’était de devenir prof. Fort heureusement, j’ai très vite su que j’étais faite pour ce métier.
Enseigner le latin et le grec en France ou en Suisse, est-ce différent?
En France, les zones d’éducation prioritaire sont précaires et difficiles, mais il est évident que ceux qui font du latin sont de bons élèves, car c’est un choix qui leur permet d’être dans de meilleures classes. Au niveau pédagogique, je trouve que la France est plus novatrice que la Suisse. L’enseignement par séquence et l’approche décloisonnée sont arrivés en Valais bien après. Depuis peu, la France a modifié sa ligne pour l’enseignement du latin et du grec, en mettant l’accent sur la culture antique plutôt que sur la maîtrise de la langue. Personnellement, je préfère nettement le choix des collèges valaisans en la matière, car j’estime que l’accès direct aux textes est exigeant, mais plus enrichissant. Ce travail rigoureux autour de la langue tend à perdre du terrain, ce que je déplore, car l’effort de compréhension engendre un plaisir particulier au contact de la beauté d’un texte.
Avoir enseigné au CO a-t-il modifié votre perception de l’école?
Au cycle d’orientation, on perçoit davantage combien les élèves ont changé en quelques années. Le collège doit désormais apprendre à s’adapter aux étudiants ayant des mesures de compensation des désavantages, donc cela nécessite une réflexion. Certains jeunes, qui avaient de bonnes notes au CO, se retrouvent un peu perdus en arrivant au collège, aussi je pense que le défi consiste à concilier avec subtilité bienveillance et exigence, en sachant créer au sein de nos classes un sentiment d’appartenance.
Eprouvez-vous le même plaisir en enseignant le latin ou le grec?
Oui. En latin, j’aime tout particulièrement les historiens romains. Tacite qui raconte la mort d’Agrippine, c’est bouleversant. En grec, je suis très sensible aux orateurs et à Homère, par exemple lorsque Andromaque voit son Hector partir. En parlant de ces textes aux étudiants, si je parviens à faire passer une partie des émotions que je ressens, c’est gagné.
Le lien entre passé lointain et présent est-il primordial?
Faire des liens avec l’actualité me paraît indispensable. Les ressources fournies aux étudiants pour analyser la littérature et décrypter les œuvres d’art leur permettent de poser un regard historique sur le monde contemporain. Avoir cette connaissance du passé aide nos étudiants, du moins je l’espère, à aiguiser leur capacité de réflexion. Quand on s’intéresse aux campagnes électorales de la Rome antique, on prend conscience qu’on n’a rien inventé.
Certains imaginent que les cours de langues anciennes sont poussiéreux. Essayez-vous d’apporter votre touche de modernité?
Donner un cours, sans essayer de le rendre intéressant et sans une part de mise en scène théâtrale dans sa façon d’enseigner, c’est vite rébarbatif. Le fait d’avoir des petits groupes favorise une ambiance presque familiale. Le travail s’y fait souvent par deux, car je trouve que c’est plus stimulant pour eux. En observant les progrès de mes étudiants au cours de l’année et au fil des degrés, je me sens valorisée. En fin de parcours, ils suggèrent des rapprochements et tissent des liens avec ce qu’ils ont appris dans d’autres cours ou en dehors de l’école, et là je me régale, car je me dis que c’est précisément la rigueur nécessaire à la compréhension des textes qui donne ensuite accès à ces passerelles. Si nous nous contentions de les laisser simplement lire des traductions de manière superficielle, nous n’aurions pas ce résultat. Bien sûr, ils doivent accepter de fournir des efforts, mais c’est dans le contrat du métier de collégien.
A notre époque où beaucoup se jettent sans aucune distance dans l’univers de l’intelligence artificielle, étudier le latin ou le grec ne pourrait-il pas apporter un petit supplément d’âme?
C’est vrai que l’étude du latin et du grec, avec sa finesse, semble éloignée de ce que propose l’IA. Utiliser ChatGPT, c’est avoir accès à de la connaissance sans en décoder le sens. C’est un outil qui existe et qui peut être complémentaire dans certains contextes spécifiques, toutefois il faut être capable d’avoir une distance critique pour ne pas se laisser piéger.
Enseigner des branches susceptibles d’être menacées, cela confère-t-il un élan supplémentaire?
Un élan je ne sais pas, mais l’envie de les défendre. Dans notre société qui vise l’utilité immédiate, c’est un combat, car on a oublié tous ces scientifiques qui avaient une vision humaniste et de solides références latines et grecques. Si nous avons réalisé un dépliant pour promouvoir l’option du latin en première année, c’est parce que nous sommes convaincus de la nécessité de montrer tout ce que cela apporte au niveau de la langue, de la logique, de l’éclairage historique et culturel. Et comme l’a dit un étudiant en classe, ils auront bien le temps pour se spécialiser après le collège.
Si vous aviez une baguette magique, comment l’utiliseriez-vous pour mieux défendre les valeurs associées à l’apprentissage du latin et du grec?
Le plus urgent est de déconstruire les idées reçues à tous les niveaux. Pour toucher un public plus large, on pourrait peut-être imaginer une journée des Antiquités ou alors une initiation obligatoire au collège. N’oublions pas que le latin et le grec mènent à tout, avec un petit quelque chose en plus.
Propos recueillis par Nadia Revaz
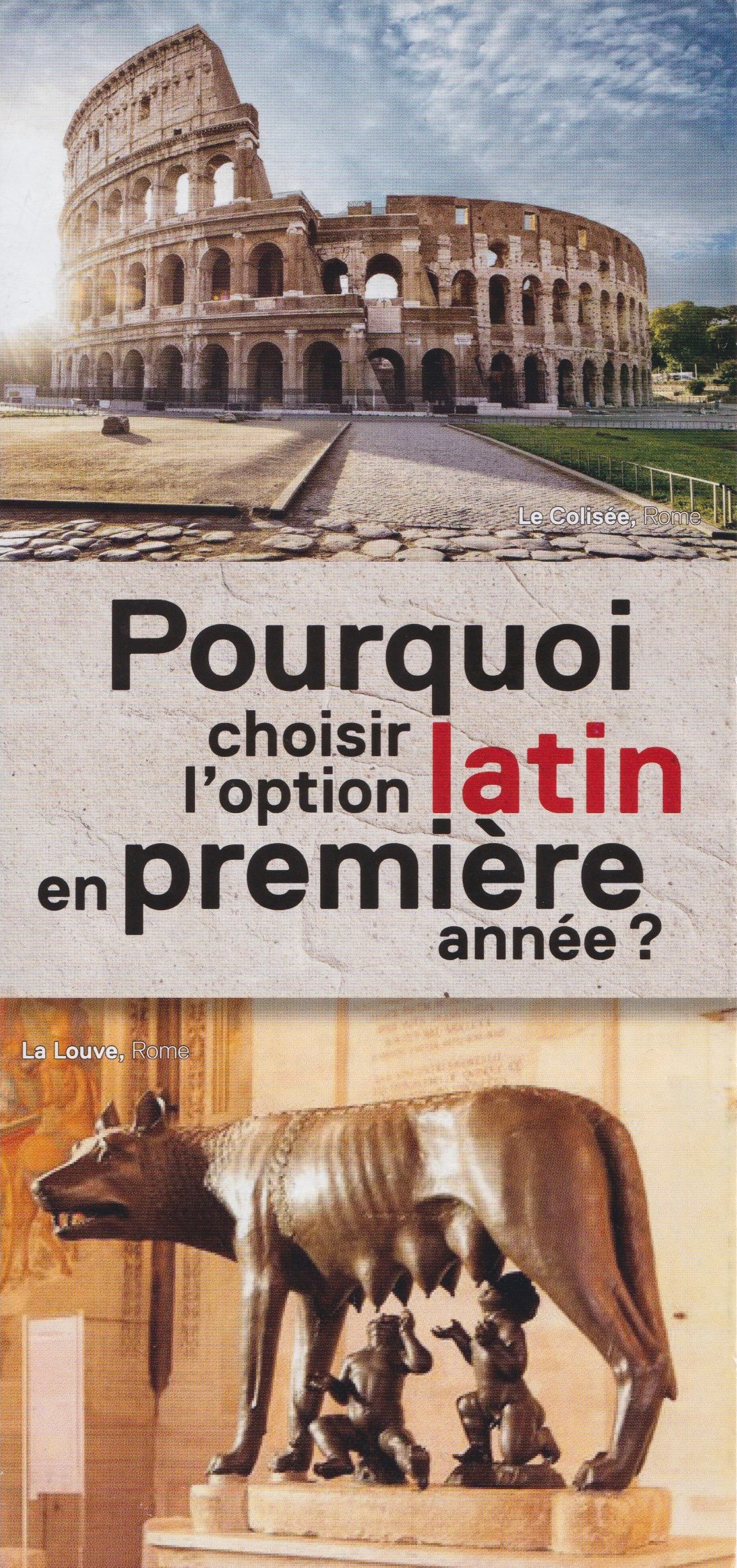
Un dépliant à lire en ligne
Pourquoi choisir l’option latin en première année?